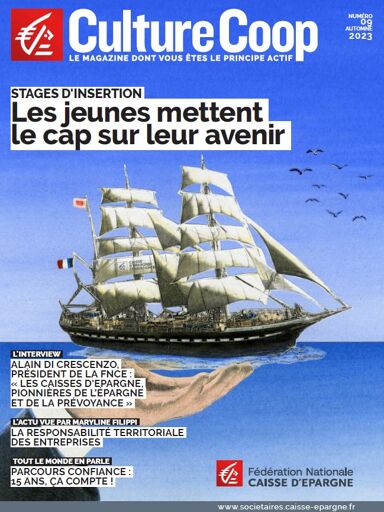-
Finance durable : interview de Frédérique Destailleur
18/04/2024
-
100 jours avant les Jeux : La France se prépare à accueillir la Flamme Olympique de Paris 2024
17/04/2024
-
Jouer le match de l’inclusion par le sport pour être #PlusProchePlusUtile avec les jeunes
15/04/2024
-
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche lance un appel à projets dédié à la préservation de l’eau
09/04/2024
Concours Coups de cœur Caisse d’Epargne
En vidéo
Les représentants des 3 associations lauréates se sont prêtés au jeu des questions / réponses.
Podcast
Podcast ESSentiel #39
ESOPE Orléans propose aux étudiants en difficultés financières des produits de tous les jours à bas prix. Lieu de rencontre et d’échange, l’épicerie met également en place des ateliers pour apprendre à cuisiner des repas équilibrés et économiques.
Notre contrat d’utilité
Le Pacte vert pour l’Europe
Quel impact et comment s’y préparer ?
A l’occasion d’un débat sur le thème « le Green Deal européen, l’avènement d’une nouvelle économie ? », Pascal Canfin, député européen et président de la commission Environnement du Parlement européen, a répondu à nos questions en apportant un éclairage sur les enjeux pour le secteur bancaire.